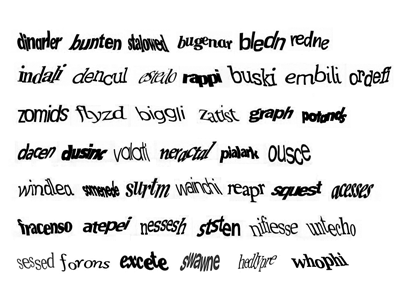La fortune du clou
 Tintin a fait un rêve dans lequel Tchang, victime d'une catastrophe aérienne en plein Himalaya, l'appelle à l'aide. Sans hésiter il se met en chemin pour aller sauver son ami. Il lui faudra traverser de terribles épreuves au terme desquelles il va réaliser cet exploit. Parmi ces épreuves il en est une, à la fois minuscule et mystérieuse, qui retient mon attention. Après une escale à New Dehli, les héros doivent se dépêcher de rejoindre l’aéroport s’ils ne veulent pas louper leur avion. Il s’installent dans un taxi dont le chauffeur leur assure qu'ils seront bientôt à l'aéroport, à moins dit-il, qu'ils ne «crèvent un pneu». Or, la vignette où figure cet énoncé, nous montre précisément un clou, la pointe vers le haut, sur la trajectoire du véhicule. Les choses semblent mal parties, mais dès la vignette suivante elles rentrent dans l’ordre : le taxi évite le clou.
Tintin a fait un rêve dans lequel Tchang, victime d'une catastrophe aérienne en plein Himalaya, l'appelle à l'aide. Sans hésiter il se met en chemin pour aller sauver son ami. Il lui faudra traverser de terribles épreuves au terme desquelles il va réaliser cet exploit. Parmi ces épreuves il en est une, à la fois minuscule et mystérieuse, qui retient mon attention. Après une escale à New Dehli, les héros doivent se dépêcher de rejoindre l’aéroport s’ils ne veulent pas louper leur avion. Il s’installent dans un taxi dont le chauffeur leur assure qu'ils seront bientôt à l'aéroport, à moins dit-il, qu'ils ne «crèvent un pneu». Or, la vignette où figure cet énoncé, nous montre précisément un clou, la pointe vers le haut, sur la trajectoire du véhicule. Les choses semblent mal parties, mais dès la vignette suivante elles rentrent dans l’ordre : le taxi évite le clou. Dans Le réel et son double, Clément Rosset livre une belle analyse de la mécanique funeste des littératures oraculaires : ce sont les tentatives pour se soustraire aux prophéties qui les réalisent. Œdipe se jette vers son destin en essayant d’y échapper. Dans la fable d’Ésope, le père, croyant soustraire son fils à son destin, l’y précipite. Je ne sais pas si on peut parler d’oracle à propos de la minuscule péripétie du clou dans Tintin au Tibet, mais d’une manière générale on peut dire de Tintin qu’il choisit délibérément d’ignorer les mises en garde ; son courage se nourrit de la magnifique surdité qu’il oppose aux prophètes de malheur qui tout au long du récit vouent à l’échec son entreprise de sauvetage. Dans ce contexte, je crois que le clou a une fonction de talisman : il figure le danger qu’on évite pour avoir su l’ignorer, non pas en surmontant sa peur, mais parce qu’à aucun moment on en a pris conscience.
Dans Le réel et son double, Clément Rosset livre une belle analyse de la mécanique funeste des littératures oraculaires : ce sont les tentatives pour se soustraire aux prophéties qui les réalisent. Œdipe se jette vers son destin en essayant d’y échapper. Dans la fable d’Ésope, le père, croyant soustraire son fils à son destin, l’y précipite. Je ne sais pas si on peut parler d’oracle à propos de la minuscule péripétie du clou dans Tintin au Tibet, mais d’une manière générale on peut dire de Tintin qu’il choisit délibérément d’ignorer les mises en garde ; son courage se nourrit de la magnifique surdité qu’il oppose aux prophètes de malheur qui tout au long du récit vouent à l’échec son entreprise de sauvetage. Dans ce contexte, je crois que le clou a une fonction de talisman : il figure le danger qu’on évite pour avoir su l’ignorer, non pas en surmontant sa peur, mais parce qu’à aucun moment on en a pris conscience.Le clou d’Ésope

Dans une de ses Fables, Ésope raconte ceci :
«Un vieillard craintif avait un fils unique plein de courage et passionné pour la chasse ; il le vit en songe périr sous la griffe d'un lion. Craignant que le songe ne fût véritable et ne se réalisât, il fit aménager un appartement élevé et magnifique, et il y garda son fils. Il avait fait peindre, pour le distraire, des animaux de toute sorte, parmi lesquels figurait aussi un lion. Mais la vue de toutes ces peintures ne faisait qu'augmenter l'ennui du jeune homme. Un jour s'approchant du lion : "Mauvaise bête, s'écria-t-il, c'est à cause de toi et du songe menteur de mon père qu'on m'a enfermé dans cette prison pour femmes. Que pourrais-je bien te faire?" À ces mots, il asséna sa main sur le mur, pour crever l'œil du lion. Mais un clou s'enfonça sous son ongle et lui causa une douleur aiguë et une inflammation qui aboutit à une tumeur. La fièvre s'étant allumée là-dessus le fit bientôt passer de vie à trépas. Le lion, pour n'être qu'un lion en peinture, n'en tua pas moins le jeune homme, à qui l'artifice de son père ne servit à rien.»

Dans cette histoire, le clou joue un rôle transitionnel entre le signifié (le danger du lion) et le signifiant (le lion peint sur un mur). Il transmet la dangerosité du lion réel à son avatar peint, supposé inoffensif. Mais dans un mouvement ironiquement croisé, c’est la matérialité même de l’idée qui est finalement fatale au fils. À moins que ce ne soit l’impossibilité psychotique de discerner entre la chose et l’idée de la chose qui le perde, dans une confusion sourde à la mise en garde de Gregory Bateson selon qui «l’idée de chien n’a jamais mordu personne».
Julien Leclou (L'argent de poche)

– Qu’est-ce qui se passe là-bas? demande l’infirmière.
– C’est Leclou qui veut pas se déshabiller! lui répond le cœur des enfants.
À la fin de L’argent de poche (François Truffaut, 1976), le jeune Julien Leclou est forcé de se déshabiller (de s’exposer), pour passer la visite médicale de son école. La maltraitance dont il est victime apparaît alors au grand jour et le film bascule vers son dénouement à la fois narratif et moral.

Comme le suggère le titre du film, l’argent de poche est à l’argent ce que l’enfance est à l’âge adulte : une petite valeur qui circule au milieu d’une plus grande. C’est également le sens que semble donner au film l’instituteur joué par Jean-François Stevenin quand il s’adresse aux élèves pour tenter de mettre en mots cette «même chose» à laquelle «tout le monde pense» : la découverte des blessures sur le corps de Julien Leclou, son (dé)placement en famille d’accueil et l’arrestation de ses parents maltraitants. Dans son discours il oppose les adultes qui ont la possibilité d’améliorer leur vie, «quand ils le veulent vraiment», aux enfants pour qui cet affranchissement est impossible, du fait même de leur non-conscience de ce qui les opprime. Ce constat est optimiste, mais sur un mode paradoxal : personne n’est condamné à souffrir … toute sa vie. Pour Julien, il admet que le mal dont il a été la victime s’est redoublé d’un enfermement dont il aura peine à sortir. Un peu plus tôt, il essayait de soulager la culpabilité de l’institutrice qui n’avait rien remarqué : «N’oubliez pas que le petit Leclou faisait tous ses efforts pour ne rien laisser paraître de ce qui se passait chez lui.» C’est cette invisibilité de la souffrance de Julien que combat le cinéma de Truffaut, tout entier solidaire des mots de l’instituteur.

Quand on découvre Julien au début du film, c’est par un lent traveling vertical, des pieds à la tête. Ce mouvement de caméra semble signifier (rétrospectivement) : voyez la force de cette vie qui pousse malgré tout. Immédiatement après cette présentation au spectateur, Julien est présenté aux élèves, et il reprend à son compte l’affirmation de cette force, en opposant l’évidence de son existence à l’incrédulité de son jeune voisin de pupitre :
– T’habites où?
– Vers les Mureaux
– Y’a pas de maisons là-bas!
– Bien sûr que si y’a des maisons, j’y habite!

Julien Leclou est le pivot de L’argent de poche. Il est la plante vénéneuse qui organise cette chronique des vies ordinaires autour du lent dévoilement de ce que personne ne veut voir. Ce n’est pas pour rien que le dernier plan du film dans lequel apparaît Julien est précisément celui où la femme médecin approche de sa poitrine un appareil qu’on suppose de radiographie et qui s’apparente beaucoup à un projecteur. Julien disparaît dans une sorte de mise en lumière à la fois attendue et redoutée.

Le clou de Chris Burden

«On peut réaliser une œuvre sans qu’il soit nécessaire qu’un objet lui soit associé. "Relique" est un mot lourd de sens, qui renvoie à la religion. Mais pour moi, les reliques n’étaient à l’origine qu’une pierre de touche. Je ne sais pas vraiment pourquoi je les ai conservées, sinon en tant que souvenirs. Ainsi des clous qui ont servi à me clouer à l’arrière d’une Volkswagen dans Trans-Fixed (1974). Je les ai gardés de nombreuses années avant de les exposer. Ils subsistent, mais pas l’objet primaire, qui était la performance, l’action … le concept!»
Ici encore le clou apparait comme objet ultime, l’instrument d’une aptitude obstinée de la matière à recueillir l’empreinte des affects – et à leur survivre.

Le clou de Georges Maciunas

Piano piece n˚13 for Nam June Paik (Carpenter’s Piano Piece)
Concert Fluxus au Fluxushall/fluxshop, New York (1964)
Le clou de Nasreddine Hodja
 Un jour, Nasreddine décide de vendre sa maison. Il trouve un acheteur et lui dit:
Un jour, Nasreddine décide de vendre sa maison. Il trouve un acheteur et lui dit:– Je vends ma maison, mais dans cette maison, il y a un clou, planté dans un mur. Ce clou, je ne le vends pas, il est à moi. Tu n'as pas le droit de l'enlever ni de l'enfoncer.
Le marché est conclu devant notaire, avec mention de la clause du clou. Le lendemain Nasreddine frappe à la porte de son ancienne maison.
– Bonjour! je viens voir mon clou.
Le nouveau propriétaire amusé par l’excentricité de Nasreddine le laisse entrer. Celui-ci s'installe quelques minutes devant son clou, le caresse puis s'en va. Deux jours plus tard, Nasreddine revient frapper à la porte.
– Je dois accrocher quelque chose à mon clou, et il y accroche un sarouel sale. L’acheteur n’est pas content mais il ne dit rien. Le jour d’après, Nasreddine revient pour accrocher à son clou une carcasse de mouton. Face aux protestations de l'acheteur, Nasreddine répond :
– C’est mon clou. Je peux y mettre ce que je veux.
Tous les jours, Nasreddine vient vérifier que la viande est toujours bien accrochée à son clou. Et jour après jour, l'odeur devient de plus en plus insoutenable. Au bout de deux semaines, l’acheteur attrape Nasreddine et lui dit :
– Tiens! je te rends ta maison! Je n'en veux aucun sou! Je veux seulement partir loin d'ici!
Et c'est ainsi que Nasreddine récupéra sa maison grâce à un clou.
Dans cette histoire, le clou détermine un espace plus grand que le sien propre, dessinant une sorte de zone franche comprenant tout ce qu'on pourra y suspendre. Cette souveraineté autoproclamée n'est pas sans faire penser au champ de l'art qui revendique l’autonomie de ses critères esthétiques par rapport à ceux du sens commun. On aurait (parfois) tort de considérer cette indépendance comme un snobisme. La plupart des artistes ont en effet la noble ambition de rétrocéder au sens commun leurs découvertes esthétiques, une fois celles-ci validées par leurs pairs. Mais il est vrai aussi que tous n'ont pas la roublardise de Nasreddine et que la plupart d'entre eux ne retrouvent jamais leur maison.
Le Corbusier
Le clou du Docteur Barbet
 Dans les sous-sols de l'hôpital Saint-Joseph à Paris, il réalise des crucifixions, mesure l’angle des bras, des jambes, ampute, radiographie, dissèque… Tout au long de son livre La Passion selon le Chirurgien, publié en 1948, il explicite sa méthode : «Venant d’amputer un bras au tiers supérieur chez un homme vigoureux, j’ai planté mon clou carré de 8 millimètres de côté (clou de la passion) en pleine paume, dans le troisième espace. J’ai suspendu doucement au coude quarante kilos (moitié du poids d’un corps d’homme qui a près d’un mètre quatre-vingt). Après dix minutes, la plaie s’était étirée, le clou était au niveau des têtes métacarpiennes. J’ai provoqué alors une secousse très modérée de l’ensemble et j’ai vu le clou franchir brusquement le point de l’espace rétréci par les deux têtes métacarpiennes et déchirer largement la peau jusqu’à la commissure. Une deuxième secousse légère a arraché ce qui restait de peau».
Dans les sous-sols de l'hôpital Saint-Joseph à Paris, il réalise des crucifixions, mesure l’angle des bras, des jambes, ampute, radiographie, dissèque… Tout au long de son livre La Passion selon le Chirurgien, publié en 1948, il explicite sa méthode : «Venant d’amputer un bras au tiers supérieur chez un homme vigoureux, j’ai planté mon clou carré de 8 millimètres de côté (clou de la passion) en pleine paume, dans le troisième espace. J’ai suspendu doucement au coude quarante kilos (moitié du poids d’un corps d’homme qui a près d’un mètre quatre-vingt). Après dix minutes, la plaie s’était étirée, le clou était au niveau des têtes métacarpiennes. J’ai provoqué alors une secousse très modérée de l’ensemble et j’ai vu le clou franchir brusquement le point de l’espace rétréci par les deux têtes métacarpiennes et déchirer largement la peau jusqu’à la commissure. Une deuxième secousse légère a arraché ce qui restait de peau». Le reste est à l’avenant, le Docteur Barbet s’autorise toutes les hypothèses «scientifiques» à l’exception de celles qui seraient en contradiction avec le texte des «Écritures». Il conclut que les clous ont été plantés «en plein carpe» (os du poignet). Or, d’un point de vue ostéologique, le carpe fait bel et bien partie de la main. Cette découverte met en conformité – à sa grande satisfaction – la science anatomique et le canon évangélique qui stipule, par la bouche de Jésus s’adressant à Thomas : «Vide manus meas – Vois mes mains». Pour finir, le docteur affirme, à propos «du seul passage anatomique préformé, chemin naturel, où le clou passe facilement et où il est maintenu très solidement», que «c’est précisément là que le Linceul [de Turin] nous montre la trace du clou, là où un faussaire n’aurait jamais eu l’idée ni l’audace de le figurer». Le Suaire de Turin est donc authentique, CQFD.
Le reste est à l’avenant, le Docteur Barbet s’autorise toutes les hypothèses «scientifiques» à l’exception de celles qui seraient en contradiction avec le texte des «Écritures». Il conclut que les clous ont été plantés «en plein carpe» (os du poignet). Or, d’un point de vue ostéologique, le carpe fait bel et bien partie de la main. Cette découverte met en conformité – à sa grande satisfaction – la science anatomique et le canon évangélique qui stipule, par la bouche de Jésus s’adressant à Thomas : «Vide manus meas – Vois mes mains». Pour finir, le docteur affirme, à propos «du seul passage anatomique préformé, chemin naturel, où le clou passe facilement et où il est maintenu très solidement», que «c’est précisément là que le Linceul [de Turin] nous montre la trace du clou, là où un faussaire n’aurait jamais eu l’idée ni l’audace de le figurer». Le Suaire de Turin est donc authentique, CQFD. Cette histoire me touche d’autant plus que le docteur Barbet était mon arrière grand-père et que le hasard le plus fortuit fait croiser nos chemins de Facteurs Cheval à la recherche du Palais Idéal ; d’un côté ses expérimentations morbides aux confins du croire religieux et du savoir scientifique ; de l’autre mes élucubrations circulaires autour du clou comme témoin de sa charge.
Cette histoire me touche d’autant plus que le docteur Barbet était mon arrière grand-père et que le hasard le plus fortuit fait croiser nos chemins de Facteurs Cheval à la recherche du Palais Idéal ; d’un côté ses expérimentations morbides aux confins du croire religieux et du savoir scientifique ; de l’autre mes élucubrations circulaires autour du clou comme témoin de sa charge.Le bois de malheur (le clou du Christ)

Andrea Mantegna, Partie centrale de la prédelle du rétable de San Zeno de Vérone, 1459, conservé au Musée du Louvre.
Pour tous les observateurs du christianisme, la crucifixion est un moment clé. Pour les croyants elle est une condition de la foi. (Jésus dit à l’incrédule Thomas Didyme qui demande à mettre ses doigts dans ses plaies pour y croire: «Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru !»). Pour les historiens elle est un élément de preuve important, si ce n’est le seul, de l’historicité de Jésus. En effet, dans le contexte du premier siècle en Palestine, la crucifixion était le plus infamant des supplices. Les premiers chrétiens étaient des juifs en train de se séparer du judaïsme et par conséquent contraints de se tourner vers les Romains pour les convertir. Difficile de les imaginer leur proposant d’adorer un crucifié (criminel et vaincu) s’ils n’y étaient pas obligés par une réalité historique indéniable, trop grosse pour être passée sous silence. «Ce que nous ne pouvons cacher, glorifions-le!» semblent s’être dit les rédacteurs des évangiles : «Non seulement nous ne dissimulerons pas la crucifixion de notre sauveur, mais nous en ferons le cœur même de notre liturgie, la condition de notre foi.»
Dans Corpus Christi (Éditions Mille et Une Nuit, 1997), Gérard Mordillat et Jérôme Prieur enquêtent sur la rédaction du texte des évangiles. Dans le chapitre consacré à la Crucifixion ils s’interrogent : «En règle générale, les condamnés [à la croix] devaient être liés. Pourquoi alors Jésus aurait-il été cloué aux pieds et aux mains comme l’indique ce passage où Thomas dit en parlant du ressuscité : “Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, je ne le croirais pas”. Cela reflète-t-il un souvenir authentique qui singularise la mort de Jésus ou cela apparaît-il pour de toutes autres raisons?» Et un peu plus loin ils avancent une hypothèse : «Les évangélistes se devaient de montrer en quoi l’exécution de Jésus se distinguait de toutes les autres. Le clouage des pieds et des mains [contribue] à la singularisation de sa mort. À la fin du deuxième siècle, Tertullien attribuait à Jésus le monopole des clous : “Seul il fut crucifié de manière si remarquable”.»
Cette distinction est particulièrement mise en évidence par Mantegna dans sa Crucifixion: des trois suppliciés du Golgotha, seul Jésus est cloué.

En lui imposant le clou, c’est un surcroit de souffrance que lui ont prescrit les rédacteurs des évangiles, mais sans doute cherchaient-ils par cette distinction à confirmer le retournement à leur avantage de la folle contrainte historique que constitue la croix dans la biographie de leur sauveur. En quelque sorte, ils enfoncent le clou.
Nous y voilà (20)

In Les passagers du vent - T4 (L'heure du serpent), de François Bourgeon, p. ?
L'exposition PEUT MIEUX FAIRE termine aujourd'hui à l'atelier Punkt
Stocofiche
Le clou de Gérard Genette
Après le Clou de la Joconde que les visiteurs se bousculaient pour admirer lors du vol de ladite en 1911 ; après la parabole spéculative inventée par John Baldessarri autour d'un tableau de Ingres qui circule de main en main jusqu'à ce qu'il n'en reste que le clou, mon Histoire du clou qui fixe l’œuvre au mur comme mesure et fondement de sa valeur prend ici un nouveau chemin. Il y est encore une fois question d’un clou qu’on évalue, mais cette fois pour lui-même et non plus en fonction de ses états de services. Dans le conte attribué par Genette à Andersen, le clou est le clou (du spectacle).
Exposition

 Depuis quelques temps, au fil de mes lectures de bandes dessinées, j’entreprends une collection de phylactères (speech bubbles) qui contiennent ces trois petits mots: Nous y voilà. Ce qui m’intéresse particulièrement dans cette exclamation c’est qu’elle articule l’intériorité des pensées du personnage avec l’extériorité du décor qui l’entoure. Elle conclut à la fois un cheminement mental et un cheminement dans l’espace.
Depuis quelques temps, au fil de mes lectures de bandes dessinées, j’entreprends une collection de phylactères (speech bubbles) qui contiennent ces trois petits mots: Nous y voilà. Ce qui m’intéresse particulièrement dans cette exclamation c’est qu’elle articule l’intériorité des pensées du personnage avec l’extériorité du décor qui l’entoure. Elle conclut à la fois un cheminement mental et un cheminement dans l’espace.La proposition d’Emmanuel de travailler avec un cahier d’exercices de type Canada Hilroy m’a donné l’idée d’éditer une série de tampons montés sur bois à partir de ma collection qui compte actuellement une vingtaine de Nous y voilà. Je me suis éloigné encore un peu plus de leur contexte original en les privant de leurs référents narratifs (le moment du récit et les éléments du décor). Ils deviennent ainsi de petits opérateurs typographiques polyvalents, prêts à l’emploi. Les visiteurs de l’exposition seront libres de tamponner un des cahiers d’exercice disposés à proximité.
 La carte du Canada sur la couverture des cahiers n’est pas étrangère à ce qui motive ma proposition. Je ne suis pas allé à l’école au Canada. Le cahier Hilroy ne travaille pas chez moi sur le mode du souvenir. Au début de l’exposition, le cahier sera vierge, comme le sont les pages d’un passeport neuf. À la fin, il sera rempli de tampons « Nous y voilà », comme le motif obsessionnel d’un papier peint bavard.
La carte du Canada sur la couverture des cahiers n’est pas étrangère à ce qui motive ma proposition. Je ne suis pas allé à l’école au Canada. Le cahier Hilroy ne travaille pas chez moi sur le mode du souvenir. Au début de l’exposition, le cahier sera vierge, comme le sont les pages d’un passeport neuf. À la fin, il sera rempli de tampons « Nous y voilà », comme le motif obsessionnel d’un papier peint bavard.Un des enjeux de ce travail est de faire exister côte à côte tous ces soliloques sans autre contexte que ce cahier voué à l’exercice. C’est un état du travail de sens et de connaissance aujourd’hui que toutes ces voix, étrangères les unes aux autres, qui arrivent solitaires au terme d’un cheminement qui nous reste inconnu.
PEUT MIEUX FAIRE – Cahiers d'exercices
arts visuels, design et créations hybrides à base de cahiers d'exercices Canada Hilroy
Du vendredi 4 septembre au vendredi 9 octobre 2009
Vernissage vendredi 4 septembre à partir de 18 h
Ouvert du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h
ATELIER PUNKT
5333, av. Casgrain (angle de la rue Maguire) - Local 205 A
Le style Tarantino
2 – Cette rotation du poignet, justement parce qu'elle a du style est adoptée par les bandits qui se mettent à utiliser leurs pétards en imitant l'image qui les imite. Le style Tarantino créé une boucle rétroactive : la mafia inspire le cinéma qui la stylise et ce faisant la modifie dans la réalité.
Je me demande s'il existe d'autres boucles rétroactives de ce type dans l'histoire des représentations, d'autre exemples d'images qui modifient leur modèle?

Par ailleurs,
on dit d'un feedback qu'il est négatif quand il a tendance à affiner l'écart entre la source (Input) et son effet (Output). On donne souvent comme exemple de feedback négatif celui du tir au pistolet. Le tireur commence par rater sa cible; il observe et analyse son erreur pour corriger son tir, tire à nouveau en réduisant l'écart et ainsi de suite. On dit en revanche qu'un feedback est positif quand il a tendance à augmenter cet écart, comme dans le cas des espèces animales qui s'adaptent à un changement de leur milieu en modifiant leur comportement.
Or,
on apprend dans Gomorra, le livre de Roberto Saviano dont est tiré le cas du style Tarantino, que les tueurs de la mafia ne «savent plus tirer comme il faut!». Le témoin, un vétéran de la police scientifique napolitaine, y affirme : «Ils ne tirent plus avec le canon droit, mais tiennent toujours leur arme inclinée, presque à plat. Ils tirent comme dans les films, le pistolet de travers, c'est un désastre : ils touchent le bas ventre, l'aine et les jambes, ils blessent grièvement mais sans tuer». Nous sommes donc en présence des effets négatifs d'un feedback positif : les tueurs de la mafia s'adaptent au goût du jour en perfectionnant leur style, mais ils tirent de plus en plus mal!
Ma chanson leur a pas plu
 «Dan Graham propose à Arts Magazine, pour son numéro de décembre-janvier 1966-67, une double page intitulée Homes for America composée d’un texte et de photographies. Quand le numéro paraît, la rédaction a substitué aux images de Dan Graham une photographie de Walker Evans. La maquette originale, reconstituée en 1970-71, forme ce que l’on considère comme "l’œuvre" Homes for America.»
«Dan Graham propose à Arts Magazine, pour son numéro de décembre-janvier 1966-67, une double page intitulée Homes for America composée d’un texte et de photographies. Quand le numéro paraît, la rédaction a substitué aux images de Dan Graham une photographie de Walker Evans. La maquette originale, reconstituée en 1970-71, forme ce que l’on considère comme "l’œuvre" Homes for America.»Il y a quelque chose de familier entre cette mésaventure et celle qui m'est arrivée à la radio de Radio-Canada où j'étais invité le 15 juin dernier. J'ai vu dans cette invitation l'occasion de diffuser enfin Les Drapeaux de Buren. Tout semblait bien ficelé avec l'équipe de recherche, le mp3 posé sur la console et, quelques instants avant d'entrer en onde, nous convenons avec l'animateur de passer la chanson au milieu de l'entretien. Pendant une dizaine de minutes, on parle. Et puis il me remercie et puis c'est fini. À la trappe les Drapeaux, malgré mes protestations. J'étais déçu. Je m'étais dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans le parcours de cette pièce qui n'arrive pas à trouver une visibilité dans le champ de l'art et qui allait se retrouver diffusée sur un média grand public. Je me disais que le jeu de miroirs entre art consacré et art populaire qu'elle propose en sortirait renforcé, et que le beau bizarre est encore plus bizarre dans un endroit où on ne s'attend pas à trouver du bizarre.
Avant l'émission, quand j'avais proposé qu'on diffuse ma pièce, je m'étais souvenu de Dan Graham et de ses achats d'espaces de publicité dans des magazines pour diffuser son travail. Cependant c'est la version officielle que je connaissais, celle où l'artiste se joue des malentendus et non celle où les malentendus se jouent de l'artiste. La découverte après coup de la publication contrariée de Homes for America m'aide à supporter mes propres contrariétés. Le conformisme des mass média est une machine puissante, même pour Dan Graham. Et puis l'anecdote a finalement tourné à son avantage, la substitution involontaire ayant installé sa proposition de part et d'autre de la frontière entre art et non-art, l'objet même qu'il cherchait à cerner.
En étant finalement déprogrammés, les Drapeaux ne font quant à eux pas apparaître grand chose, mais l'histoire n'est peut-être pas terminée ...
Le clou de Lester Freamon

Pour le dire autrement

Il y a un Lion de Belfort à Montréal, au Square Dorchester. Réalisé en 1897 par le sculpteur George William Hill, ce Lion est une copie en granit de celui de la place Denfert–Rochereau à Paris, réalisé par Frédéric Bartholdi (le sculpteur de la statue de la Liberté). Si le lion montréalais symbolise la force du protectorat britannique, le lion parisien symbolise quant à lui la défense nationale française. La permutabilité des symboles nationaux est réjouissante, mais cette reproduction évoque aussi pour moi une histoire personnelle.
Un beau jour, alors que j’avais terminé mes études d’artiste depuis quelques mois et que je vaquais dans les rues de Paris, je constatai l’absence du Lion de Belfort sur son socle. Associant aussitôt cette vacance à la mienne, je perçus comme un effet miroir entre le retrait de la sculpture et mon désœuvrement de sculpteur. De cette identification me vins l’idée qu’il pouvait s’agir là d’un clin d’œil du destin, d’un petit coup de pouce comme on dit quand on a des relations : une occasion à saisir. Renseignement pris auprès des autorités compétentes, j’appris que le lion était en rénovation pour quelques mois. Avec de la feutrine et de la fourrure artificielle, je me confectionnai un masque et un costume de lion. À la suite de quoi je montai sur le socle vacant afin d'y assurer une vigie citoyenne au milieu de la circulation automobile.
Quelque temps plus tard, je quittai Paris pour Montréal où les modalités de la vraie vie sont un peu différentes, mais non moins véritables. Les années passèrent encore et je me retrouve dans la situation de dessiner le récit de cette ancienne performance. En me documentant, je découvre l’existence de la réplique montréalaise du lion. Je ne peux m’empêcher de voir cette coïncidence comme un passage secret entre mes deux villes, une clé sans puits pour la perdre.
L'angoisse de Donald
On peut faire de ce gag, lu dans Picsou magazine il y a environ 25 ans, une lecture rétrospective. Ce qui n’était pas possible alors (savoir qui est au bout du fil sans décrocher) est devenu une fonction essentielle, bien qu’optionnelle, des téléphones contemporains. Désormais, au son du timbre un nom s’affiche.
Il y a cependant quelque chose dans l’angoisse de Donald qui échappe à cette lecture anachronique. La sonnerie du téléphone comprime la quantité vertigineuse de toutes les ignorances du canard dans un monde possible devenu dès lors minuscule. La certitude du neveu, elle, s'offre un monde infini au delà des limites du plausible (« si cela avait été l’oncle, le combiné se serait soulevé dans les airs au dessus de son socle »).
L’absence de gestuelle du téléphone donne un renseignement formel : ce n’est pas l’oncle Picsou qui appelle.
Mais alors qui ?
Indécision